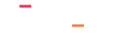Le baryton Edwin Crossley-Mercer souffrant sera remplacé par Jóhann Kristinsson pour le concert du 15 octobre.
Sommets de l’orchestre
Modifié le :

Mozart, le ciel et les nuages
Entretien avec David Fray
Natif de Tarbes, formé au CNSM de Paris, titulaire de nombreux prix, David Fray est aujourd’hui un pianiste recherché sur toutes les scènes internationales. Artiste accompli, toujours en quête de nouveaux horizons, il est le fondateur et directeur artistique du Festival « L’Offrande Musicale », dont la première édition s’est tenue en été 2021 dans les Hautes Pyrénées. Le 23 avril à la Halle aux grains, il retrouvera l’Orchestre national du Capitole et le chef Frank Beermann pour le Concerto n° 21 de Mozart. C’est l’occasion de découvrir son approche du génial compositeur.
Vous connaissez- bien l’Orchestre national du Capitole : quelle a été votre expérience avec lui ?
Je le connais et l’aime depuis de nombreuses années ! Il y a quatre ans, nous avons même enregistré ensemble un disque chez Warner consacré aux concertos pour deux, trois et quatre claviers de Bach, un répertoire plutôt inattendu pour l’Orchestre, qui avait été pour moi l’occasion de le connaître sous un autre angle, car il s’agissait d’une formation réduite d’une quinzaine de musiciens, adaptée au répertoire. Le rapport était plus direct, plus personnel, sans l’intermédiaire d’un chef, puisque je dirigeais moi-même depuis le piano. J’en ai un excellent souvenir.

Lors du concert du 23 avril, vous interpréterez le Concerto n° 21 en ut majeur de Mozart. Parlez-nous de cette pièce…
Étrangement, c’est un concerto que je n’ai joué qu’une fois jusqu’ici – c’était tout récemment à Monte-Carlo. À vrai dire, j’hésitais à l’aborder : le deuxième mouvement est si célèbre qu’il me mettait sous pression ! C’est un peu comme jouer la Lettre à Élise ! Mais ce qui est merveilleux avec ce genre de pièce, c’est qu’elle a beau avoir été jouée des milliers de fois, rabâchée, malmenée parfois, il suffit d’ouvrir la partition, de revenir au texte, de puiser à sa source pour que la magie opère, pour que la fraîcheur, la beauté infinie de cette ligne surgisse aussitôt. Alors on oublie tout le reste, et j’ai eu le sentiment d’entendre cette musique pour la première fois, de la jouer avec une sorte de candeur. Je suis heureux d’avoir enfin ce Concerto à mon répertoire, c’est une pièce splendide.
Quel est votre préféré ?
Difficile à dire ! De toute façon, à partir du Concerto n° 20, on n’a affaire qu’à des chefs d’œuvre absolus : les développements sont savants, l’écriture mozartienne est à son apogée. Mais j’avoue avoir une tendresse particulière pour le n° 24 en do mineur, que j’ai d’ailleurs joué avec l’Orchestre national du Capitole. La tonalité mineure y trouve une expressivité toute particulière, un mélange alchimique des sentiments qui me rappelle celle de la trilogie da Ponte.
L’opéra est-il une référence pour vous ?
De manière générale, j’ai une passion pour la voix – elle est la référence qui guide tout mon travail de pianiste. Et j’aime évidemment l’opéra. En ce qui concerne Mozart, je trouve que les trois ouvrages composés avec Da Ponte (Les Noces de Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte) sont des sommets indépassables. Ce qui me frappe, c’est justement l’extrême subtilité des émotions, leur mélange, la coexistence de sentiments contradictoires. Dans l’opéra baroque, chaque aria exprime une passion et une seule, bien spécifique : la joie, la tristesse, la colère, la jalousie, etc. Chez Mozart, joie et tristesse, sourire et larmes sont intimement mêlés, au point d’être inséparables. Ce n’est pas un hasard s’il définit son Don Giovanni comme un dramma giocoso, un « drame joyeux » : c’est la définition même du génie mozartien, et de sa modernité. Je crois qu’il a été le premier à parvenir à une telle perfection psychologique, et peut-être même a-t-il été le seul… Schubert lui aussi a atteint cette finesse d’expression, mais pas dans l’opéra. Or en effet, j’aborde les concertos de Mozart en référence à ses opéras : on y découvre une fascinante dramaturgie, on y imagine des personnages, des situations qui ouvrent des perspectives infinies d’interprétation. Il me semble que les opéras révèlent ou déplient ce qui est en jeu dans l’œuvre instrumentale en termes de langage musical.
Que demande l’interprétation de la musique de Mozart ?
Pour moi, Mozart est comme un ciel : l’espace est là, immense, immuable, et le passage des nuages lui donne mille nuances différentes et sans cesse changeantes. L’interprète mozartien doit être capable de préserver l’unité tout en passant par une infinité de nuances. Je ne prétends pas y arriver, mais c’est vers cet idéal que je tends.
Propos recueillis par Dorian Astor
Bruckner, le génie modeste
Entretien avec Frank Beermann
Nous devons au grand chef allemand Frank Beermann les grandioses souvenirs de sa direction de Parsifal, Elektra et La Flûte enchantée à l’Opéra national du Capitole. Il revient face à l’Orchestre, cette fois – et pour la première fois – à la Halle aux grains et dans le répertoire symphonique. Et quel répertoire ! Après le Concerto pour piano n° 21 de Mozart, le programme du 23 avril se poursuivra avec l’immense Septième Symphonie de Bruckner.

Vous êtes désormais familier de l’Opéra national et de l’Orchestre national du Capitole dans la fosse. Mais c’est la première fois que vous abordez le répertoire symphonique avec celui-ci. Le travail sera-t-il différent ?
L’expérience au Théâtre a été magnifique. Le travail a été constructif, inspirant, cet orchestre a une sonorité spécifique qui est tout à fait admirable. De plus, le contact avec les musiciens a été précieux, nous avons développé une très belle relation humaine. C’est vraiment une grande joie de les retrouver sur la scène de la Halle aux grains. Quant à la nature du travail, c’est la musique et le répertoire qui, chaque fois, la déterminent. Sur le fond, la relation est la même, mais il y a des différences liées au temps de répétition et également à la salle. Je vais découvrir la Halle aux grains : il faut trouver le jeu adapté à l’espace, naturellement très différent d’une fosse d’orchestre ! La relation entre une partition et un espace est absolument primordiale, et elle change à chaque concert. Mais avec l’OnCT, je n’ai aucune inquiétude : ils ont la souplesse et l’état d’esprit requis, ils sont aussi performants dans l’opéra que dans le répertoire symphonique. Nous prendrons en compte ensemble les paramètres qui changent : l’espace, le son, le style.
Bruckner a longtemps été un compositeur mal-aimé. En revanche, sa Septième Symphonie a joui d’un succès précoce et durable. Comment l’expliquer ?
Il y a, je crois, deux raisons à cela. La première c’est que la Septième a été créée à Leipzig (sous la direction d’Arthur Nikisch, en 1884), c’est-à-dire loin de Vienne ! Bruckner s’est toujours heurté à de fortes résistances à Vienne : hostilité, mépris, cabales. Je ne veux pas dire du mal des Viennois, mais je crois qu’ils ont sous-estimé Bruckner parce que lui même était trop modeste… La deuxième raison est purement musicale : la Septième est sans doute la plus lyrique, la plus accessible de ses symphonies : le dernier mouvement, par exemple, possède une légèreté qui fait songer à Haydn ! Elle parle immédiatement au public.

En même temps, la Septième a quelque chose de surdimensionné : n’est-ce pas un défi de pénétrer dans cet univers gigantesque ?
Certes, c’est monumental. Mais j’insiste sur cette modestie brucknérienne dont je parlais plus haut. Ce n’est pas qu’un trait psychologique, c’est une forme d’expression. Et de ce point de vue, Bruckner ne peut être comparé à personne d’autre : il est le premier compositeur (seul peut-être Bach avant lui) qui n’ait jamais écrit à partir de son égo, de sa subjectivité. Il ne s’agit jamais de sa personne, on sent qu’il est toujours à la recherche de quelque chose de plus grand, pour ainsi dire d’une dimension cosmique. En réalité, sa musique est si asubjective, si abstraite quelquefois, qu’elle ouvre précisément la possibilité d’une plongée cosmique. Or cela autorise, nécessite même à chaque fois une nouvelle interprétation, une approche renouvelée, expérimentale. J’ai dirigé cette œuvre plusieurs fois, et en effet, selon l’orchestre, le lieu, la tradition de jeu, l’atmosphère même, c’est chaque fois un nouveau visage de l’œuvre qui m’apparaît. Cela demande naturellement du travail et du temps, mais c’est une expérimentation fascinante, appelée par l’écriture elle-même. C’est un bonheur parce que c’est aussi une expérience de liberté totale.
On est parfois tenté de comparer Bruckner à Mahler, parfois au profit du second. Quelle est leur parenté, et qu’est-ce qui les distingue ?
Leur parenté est superficielle : bien sûr, même conception monumentale, cosmique de la symphonie, ce qui est lié à l’époque. Ils partagent une même tradition, et on peut relever des parallèles. Mais profondément, leur différence est radicale, aussi radicale que celle qui oppose Wagner et Brahms ! La musique de Mahler est, justement, un véritable cri de l’égo, c’est la musique la plus subjective qui soit ! C’est d’ailleurs ce qui fait sa puissance émotionnelle incroyable. Mais Bruckner, c’est l’opposé : une émotion tout aussi puissante, mais à partir d’une source expressive radicalement autre. Bruckner croit à une rédemption suprapersonnelle, cela fait toute la différence.
Propos recueillis par Dorian Astor